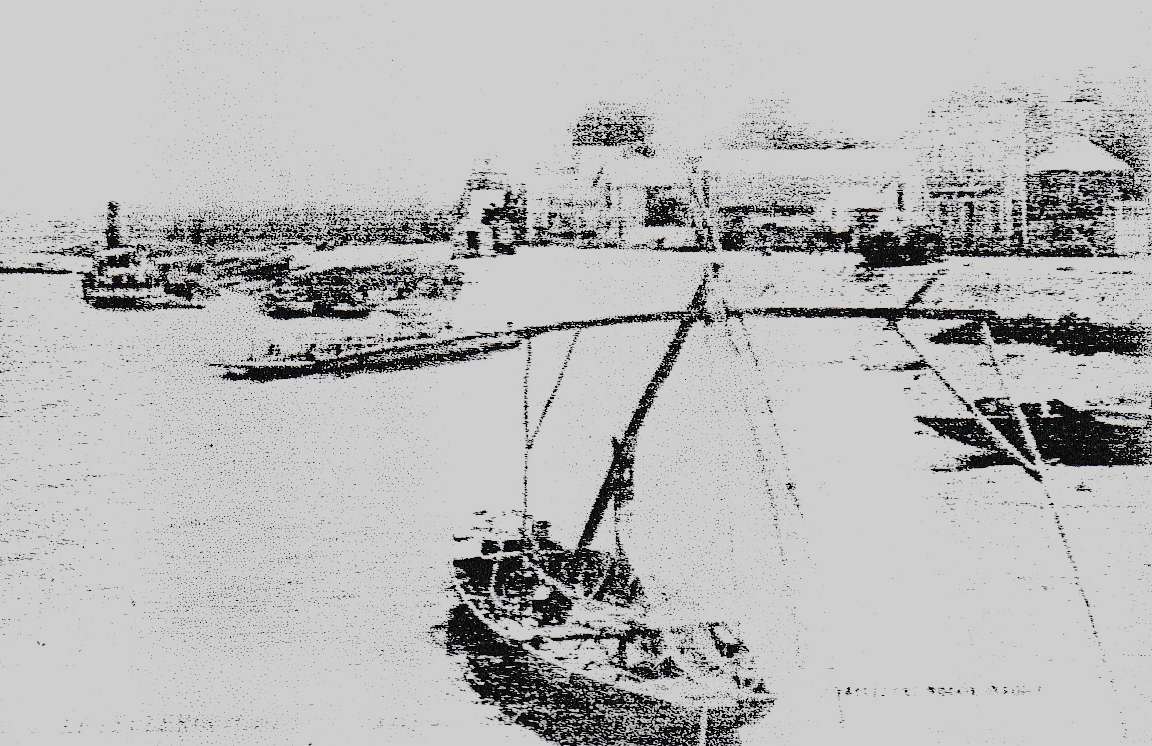|
Nous sommes le 12 juin 1992, René Mocquard qui est né en 1917 ne peut pas savoir qu'il
lui reste moins de deux ans et demi à vivre. Pourtant le mal qui le ronge s'est déjà manifesté depuis un
bon moment et l'oblige à de fréquents séjours à l'hôpital de Nantes dont les échéances se rapprochent
malheureusement de plus en plus. Mais si le corps souffre, l'esprit, lui, est toujours aussi vif et l'œil
étincelle encore, signe d'une grande santé morale et d'une vivacité d'esprit peu communes. Ces deux
qualités, compagnes d'une personnalité en rapport, il va en faire preuve au cours des deux séances où il
va nous narrer ses souvenirs. Il saura les émailler tout au long d'anecdotes parfois fort savoureuses
avec son franc-parler que son érudition pouvait lui permettre, mais cela sans jamais dépasser les bornes
et en restant d'une grande discrétion sur les patronymes des intéressés. Au cours des deux entrevues
qu'il nous a accordées et pour créer un fil conducteur dans la conversation sur le passé de notre commune
et de ses environs, des reproductions de vieilles cartes postales lui ont été présentées. Celle de dessus
représentait l'inauguration de la salle de La Clotais qui eut lieu en juin 1930.
Tilt !
« Cela se passait à la salle de La Clotais. Oh! ça devait être avant
la deuxième guerre mondiale, dans les années 36 à peu près. A l'époque à La Clotais on faisait ce qu'on
appelait des concerts. Il y avait les gens de l'Amicale qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Société de
Défense Laïque qui chantaient, qui faisaient de la musique mais on faisait venir aussi des gens de
l'extérieur. Et cette fois-là, c'étaient des gens qui étaient venus jouer « Les noces de Jeannette
», c'est une petite opérette où on voit un jeune homme et une jeune fille qui
veulent se marier, mais le garçon n'a pas tellement envie de se mettre la bague au doigt tout de suite.
Alors il y a toute une discussion avec trois personnages : la fiancée, le galant et puis le beau-père.
Enfin je te passe… ils chantent, ils s'engueulent etc. Et à un moment donné, le fiancé s'en va vexé comme
un dindon. Il s'en va en claquant la porte. Hélas, les décors ne devaient pas être tellement bien tenus.
Les voilà tout d'un coup qui s'abattent comme un château de cartes sur les acteurs. Et alors, le mieux,
je ne te citerais pas les noms des gens en question, il y avait les deux machinistes qui étaient derrière
… bien attablés avec un kilt de rouge et deux verres, alors tu imagines le succès mais ç'a n'a troublé
personne, y a trois ou quatre personnes qui sont montées et qui ont remis en place les trois panneaux
tombés.
Et puis le spectacle a repris. Tout le monde a trouvé ça très drôle. Ce qu'il y avait encore de plus
amusant dans cette affaire-là c'est que le jeune homme et la jeune fille étaient dans la vie des gens
mariés et la jeune fille qui était une pure demoiselle dans la pièce, dans la réalité était … enceinte
de six mois. Ca se voyait largement. Cela ajoutait encore du piment à cette affaire »
Le ton était donné, il n'y aurait pas de suite fastidieuse de souvenirs plus ou moins vagues mais
bien une narration extraordinairement vivante de faits quotidiens qui dépeignent si bien les mœurs
d'antan. Ce premier pas franchi, d'un simple fait-divers concernant un spectacle vécu il y a près de
soixante ans, la conversation devait naturellement dériver vers ce qui marquait la vie autrefois :«
… la vie collective était peut-être plus importante et puis malgré tout il n'y avait
pas la télé, ni des choses comme ça et même si je me rappelle bien on devait faire des représentations de
cinéma. Mais à La Clotais, il y avait aussi les garderies. Les garderies c'était vraiment peu de choses,
en fait il y avait trois ou quatre femmes de bonne volonté puis un ou deux jeunes gens qui faisaient
leurs études. J'en étais un, Gisèle en était une autre (N.D.L.R. : elle allait devenir son
épouse) et on gardait les gosses qui se débrouillaient. Alors dans la salle du bas,
on faisait ce qu'on appelait du cinéma, c'est-à-dire que toutes les semaines, j'allais à Nantes chercher
des petites bobines. C'était du cinéma muet qu'on tournait à la main et les gens étaient heureux comme
tout de voir le cinéma. On leur donnait un goûter alors, c'étaient des petits pains qu'on achetait au
boulanger de la Télindière et puis on mettait, je crois bien que c'était de la confiture. Puis on y avait
renoncé, ils s'en mettaient partout. Alors vers la fin on devait donner du chocolat et puis surtout on
mettait du vin mêlé avec de l'eau, oh ! c'était vraiment teinté.»
»

|
« Je me
souviens d'une anecdote, je ne me rappelle plus à qui c'est arrivé. On ne surveillait pas trop ce sacré
tonneau. C'est un tonneau qui était derrière dans le bar du bas. Un jour, je vois des gosses qui
sortaient de la petite salle du bas :
- Qu'est-ce qu'ils ont été foutre là-dedans ? Viens donc par là. Oh ! je dis, mon salaud, t'as été goûté
le vin qu'était pas mêlé, hein ?
Le gosse, il était un peu rond. Je lui dis :
- Vas donc t'étendre sur l'herbe. Tu vas dormir un peu et puis ça va se passer.
Après on fermait la salle du cinéma. Mais les gosses venaient …, je crois que c'était 2 fois par semaine
l'après-midi mais on ne leur organisait plus de jeux et les enfants trouvaient eux-mêmes leurs activités.
On avait certains petits jeux, il y avait des jeux de cartes, tu sais des jeux de petits cochons, des
machins comme ça, mais ils discutaient et jouaient entre eux. Le plus embêtant, c'était quand il
pleuvait, on était obligé de les mettre dans la grande salle, j'aime autant te dire que c'était du sport,
parce que la grande salle était parquetée comme maintenant, alors évidemment … , oh ! il devait bien y
avoir une centaine de gosses à l'époque, avec cent gosses là-dedans à chahuter, j'aime autant te dire que
la poussière était assez élevée et c'était moi qui, pendant ce temps-là, allais goûter un peu le vin mêlé
parce que ça donnait soif ».
Si l'existence dans notre commune restait imprégnée par
le mode de vie rural, il n'en était toutefois pas de même de la grande
ville nantaise qui se situait à proximité immédiate. Ce qui fait que les
contacts ne se déroulaient pas toujours de façon agréable et certains
citadins pouvaient jeter un regard plein de condescendance pour les habitants
d'une si petite cité campagnarde, ce qui pouvait susciter parfois des
réactions épidermiques parmi nos concitoyens susceptibles. Aussi, René
Mocquard, jamais à court d'amusantes histoires propres à illustrer notre
passé local nous rappelle que : « pour les
nantais, St Jean de Boiseau, c'était vraiment le bout du monde et quand
on te parlait de Saint Jean de Boiseau, c'était vraiment pour te dépeindre
le paysan mal dégrossi avec les gros sabots et le canard dans le panier.
Y avait d'ailleurs des amuseurs publics dont tu as peut-être entendu parler,
Peignon de la maison de location de costumes et Sauvaget qui en avaient
fait leur cheval de bataille, c'est-à-dire la brave paysanne de Saint
Jean de Boiseau qui débarquait de St Jean et qui racontait ses histoires.
Et alors effectivement à la Mi-carême, très souvent, il y avait un char
qui représentait les habitants de Saint Jean de Boiseau. Certains prenaient
ça en rigolant, d'autres étaient un peu vexés parce qu'évidemment ça ne
relevait pas le niveau. Cela me rappelle encore une anecdote concernant
cette façon de faire. Il s'agissait de ma tante. Ma tante était une personne
bien bâtie, une forte femme maigre, tu sais grande, elle avait l'habitude
quand elle faisait ses courses de discuter le prix et un jour, chez Decré,
elle achète … mettons du tissu. Elle dit alors à la commise :
- Et ben dites-donc, vous allez bien me casser un peu quelques sous. Alors la commise lui dit
:
- Ah ! on voit bien que vous êtes de Saint Jean de Boiseau, vous. Bon Dieu, ma tante se fâche
et réplique :
- Ma fille, j'suis p'têt ben de Saint Jean de Boiseau, mais mes sous, tu les vois là, et ben tu
les verras p'us. Elle ramasse ses sous, elle lui a refoutu le rouleau du machin qu'elle avait
acheté et puis elle est foutue le camp.
Elle avait raison après tout. Elle n'était pas là pour se faire insulter surtout qu'à l'époque,
les filles de chez Decré, tu sais, se croyaient beaucoup. Decré à l'époque, c'était la boîte
chic de Nantes, mais pour les vendeuses, il fallait être recommandé par son curé pour y rentrer
. Ah oui ! c'étaient toutes « des filles d'archevêque » et elles se croyaient beaucoup vis à vis
des gens de la campagne.
Il y avait Saint Mars la Jaille, au nord qui avait aussi cette réputation, mais pour nous
c'était surtout Saint Jean de Boiseau. Alors St Jean, pourquoi ? Je n'en sais rien, c'étaient
les bousous ».

|
Les cartes postales défilent, quelques historiettes seront narrées telle celle de cet ami (avec
qui il fut très lié, il le fallait pour qu'il lui raconte cet événement important de sa vie) qui
perdit sa virginité dans une « beurouette » dissimulée parmi quelques javelles de roux et qui
conclut son récit par un péremptoire : « Oh ! il dit, ça été vite fait
parce que tu sais j'étais jeune à l'époque ».
La vie aux champs apparaît maintenant sur les images qui passent entre ses mains. C'est l'occasion
de reprendre son récit :« pour le ramassage du raisin, il y a ce qu'on appelle le ban des
vendanges, c'est-à-dire qu'on ne pouvait commencer à ramasser le raisin qu'à partir de la
proclamation du ban. On appelait ça le ban des vendanges et ça fixait la date. Cette date, je
pense que ça existe toujours pour les vins contrôlés. Mais ici, ça existait quel que soit le
cépage.
C'est sans doute une tradition seigneuriale, féodale pour pouvoir contrôler la récolte et après
ça été pour pouvoir contrôler à l'échelle des Indirects. Quand le ban des vendanges avait été
publié, il y avait le droit de râper dans les vignes qui étaient vendangées. C'était le droit
de ramasser les raisins qui étaient oubliés ou mal mûris et il y avait un bonhomme dont je
tairais le nom qui habitait Boiseau et qui avait pas mal de vin. Et on lui disait :
- Dites-donc père … machin. Ah ! dites-donc, vous avez du vin cette année ?
- Ah là là, j'ai été râpé un peu partout avec ma femme et ma fille et pis, alors, mon vieux on
en a ramassé !
Les mauvaises langues disaient :
- Ben oui, ah ben oui. Y peut ben aller râper, parce que la nuit y va râper aussi et sa beurouette,
elle est ben graissée et pis les roues sont entourées de chiffons, le vieux fis de garce.
Et un jour, le « vieux fis de garce » en question est tombé sur des gens qui l‘attendaient dans
les vignes non vendangées et puis, ma foi, il a eu une barriquée de coups de bâton. Enfin, il
a quand même continué à ramasser du vin qui était râpé comme ça et il se faisait 3 à 4 barriques
».
A raison de six basses par barrique et de 10 à 12 baquets par basse,
nous précise-t-il, cela faisait une belle récolte. Mais laissons-le reprendre
le cours de son récit pour nous apporter une petite précision complémentaire
: « ... Fallait pas trop les remplir surtout
que c'était en charrette (le voyage).
Les basses, en réalité, le terme exact, ce n'est pas basse b,a,s,s,e mais
bâts b,â,t,s parce que la basse était faite pour être accrochée sur la
selle d'un âne … Il y avait aussi une autre mesure de vendange qui s'appelait
la somme. La somme c'étaient deux basses parce que l'âne en avait une
de chaque côté pour équilibrer la charge. Personnellement, je n'ai jamais
connu les ânes dans les vignes. On sortait ça avec un portoir. C'était
le terme exact. Suivant le raisin, on pouvait laisser bouillir dans les
basses mais c'était assez rare. La plupart du temps, on pressait tout
de suite, on l'amenait au pressoir, on le passait à l'égrenoir et aussitôt
après on laissait égoutter un peu et on faisait le cep dans des pressoirs
à long fût ou à cage. Pour le noa, il fallait mettre de la paille et il
fallait surtout le laisser égoutter un bon moment. Quand tu faisais une
presse très lente, … alors on disait qu'il « chiait » et quand le cep
était bien égoutté, on faisait ce qu'on appelait la « recoupe ». On défaisait
tout, on refaisait un deuxième cep, on mettait les coupes dessus et on
pressait de nouveau.
On tirait vraiment jusqu'à la dernière goutte, c'était comme du bois. Ce que
je n'arrive pas à piger, c'est que avec cette râpe-là, on arrivait quand même
à faire de l'eau-de-vie. Oh, j'aime autant te dire qu'elle n'était pas bonne mais je me
souviens que dans la plupart des maisons, on faisait surtout de l'eau-de-vie
de lie. C'est-à-dire qu'au premier soutirage qui avait lieu si je me rappelle
bien aux premières gelées, soit pratiquement au mois de janvier, on ramassait
ce qui était au fond de la barrique et on mettait ça dans un tonneau spécial
qui servait à faire l'alcool. Alors l'eau-de-vie était encore buvable mais
l'eau de vie de râpe c'était absolument …Fallait être trois pour boire le
verre. Le premier pour commencer et les deux autres pour le finir.
Lors des vendanges, on mangeait au bout du rang et les journées étaient
longues parce que parfois, il fallait presser tout de suite. Certains
laissaient fermenter sur la râpe et alors le vin prenait la couleur du fruit
et devenait rouge. Ici on le faisait de moins en moins parce que le vin avait
un goût un peu de tanin, ce que les gens aimaient ici, c'était le vin rosé,
le vin qu'on appelait pierre de fusil ».

|
Des vendanges on en arrive tout naturellement à un autre
temps fort de la vie rurale de nos ancêtres : les battages. « … le blé était ramassé en bottes et, entré dans les fermes, on faisait des mulons
immenses. Il y avait ce qu'on appelait la batterie c'est-à-dire une batteuse
qui était tractée par une locomobile. Cette locomobile là, c'était pratiquement
une machine à vapeur qui servait d'énergie pour la batteuse. Elle passait
dans les fermes importantes et restait à peu près la journée quoi ! Tout
le monde se donnait la main, on battait chez l'un et les autres cultivateurs
venaient et s'entraidaient. Evidemment, nous les gosses, on allait faire
la batterie, en fait on regardait ça parce que c'était très spectaculaire.
Je ne sais pas si tu vois la batteuse, c'était quand même assez haut et
il fallait que les gars y mettent la botte, il y avait ceux qui étaient
sur la batterie qui défaisaient la botte, c'était très dangereux parce qu'ils
étaient au-dessus du mécanisme et des courroies et alors sortaient le blé
d'un côté qui était à peine ventilé - il n'était pas très propre - et les
bottes de paille de l'autre. Ca durait à peu près une journée en pleine
chaleur, le soir, j'aime autant te dire qu'il y avait pas mal d'assoiffés.
Peu de pauses dans la journée parce que la machine demandait et puis c'était
une machine à vapeur qu'il fallait entretenir continuellement. Il n'y avait
que le repas de midi et peut-être une petite sieste après. Ah, Il y avait
quelque chose de spécial, c'était que dans les repas de batterie, fallait
jamais donner de purée. Pourquoi ? J'en sais rien ! C'était une tradition,
si la maîtresse de maison avait le malheur, parce que c'était un repas en
commun évidemment, de faire de la purée, sa maison était maculée ... ».
Farces, bonne humeur et joie de vivre étaient donc des valeurs morales
reconnues et que tout un chacun s'efforçait de faire perdurer. Mais il
pouvait arriver aussi que des motivations moins valorisantes soient à
l'origine de celles-ci et conduisent parfois à des situations moins drôles
ainsi : « … il y a des tours qui
ont été faits par des jeunes qui sont disparus. Paix à leur âme. C'était
à l'époque où il y avait quand même une animosité assez grande, beaucoup
plus grande que maintenant entre ce qu'on appelait les « calotins » et
ce qu'on appelait les « rouges ». Les calotins n'étaient pas plus calotins
que maintenant et les rouges étaient aussi pâles qu'ils le sont maintenant
mais les gosses avaient pris évidemment le parti et les gars de la « laïque
» attendaient les « calotins », car il n'y avait pas de transport, les
gosses se tapaient Saint Jean de Boiseau/La Télindière à pied. Les instits
avaient essayé de décaler les sorties de façon à éviter les conflits,
ça permettait simplement à ceux qui sortaient les premiers de pouvoir
s'embusquer plus à l'aise pour lancer des cailloux ou se battre avec les
autres. C'était une atmosphère assez déplaisante d'ailleurs, les jeunes
se battaient et faisaient des farces aux « calotins ». L'école du Diable
s'attaquait à l'école du Christ. Les jeunes dont il est question, de la
« laïque », là avaient bien le diable dans la peau. Un jour, deux galopins
avaient décidé de faire une farce aux bonnes femmes qui allaient à la
messe le vendredi matin. Parce que pour les croyantes, on allait communier
toutes les semaines le vendredi matin. Elles partaient à six heures du
matin, donc en pleine nuit en hiver et y allaient à jeun d'ailleurs, ce
qui prouve qu'elles avaient de la santé. Ben oui, tu sais elles méritaient
leur paradis et les deux galopins en question avaient mérité aussi leur
enfer. Ils s'étaient levés un peu plus tôt et avaient été acheter des
feux tournants, je ne sais pas où et avaient installé ça sur la croix
de La Clotais. Evidemment les bonnes femmes arrivaient en groupes. Quand
les bonnes femmes ont été à 20 ou 30 mètres de là, ils ont allumé et quand
celles-ci sont passées devant la croix, tout d'un coup pschitt, pschitt,
voilà la croix qui s'illumine :
- C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, on est maudites etc.
Et elles ont couru jusqu'à l'église où le curé évidemment a dit :
- Bon, on va aller voir.
Alors, il a compris tout de suite.
Ils avaient aussi une autre blague mais qui était moins spectaculaire mais aussi vache, c'était à la croix Truin. Alors là,
ils avaient installé deux citrouilles, les fameuses citrouilles « têtes de mort », ils les avaient évidées, mis deux yeux, une
bouche et puis une bougie et les avaient tournées de façon qu'on ne les voit pas et puis quand les bonnes femmes sont
arrivées, les ont retournées, alors c'est apparu dans la nuit. Ca été la terreur aussi. Malheureusement les deux jeunes
qui ont fait ça sont morts depuis longtemps. C'est pour te dire qu'on avait des façons de s'amuser qui étaient peut-être
un peu brutales à l'époque.
Il y avait alors une animosité physique entre les « blancs » et les « bleus » assez nette, et qui, quelquefois provoquait des
conflits assez vifs. Un climat existait qui avait été créé par l'école confessionnelle. Ainsi dans l'arrière pays de Retz,
moi j'ai connu des instituteurs à qui on ne vendait pas le pain et qui étaient obligés de se déplacer en vélo pour acheter
leur pain et leur viande dans des coins où ils n'étaient pas connus. Si l'école pouvait se maintenir avec si peu d'enfants,
c'est parce qu'à l'époque la rentabilité n'était pas ce qu'elle est maintenant et puis il faut bien reconnaître que si on
voulait maintenir des gens à l'école, il fallait bien qu'elle soit là parce que les moyens de transport n'existaient
pratiquement pas. C'était déjà pas mal que dans les communes comme celles de notre pays de Retz, les gens puissent y
aller car les gosses étaient parfois obligés de faire de sacrés chemins ».
Les cartes postales continuent leurs apparitions et rappellent quelques souvenirs à
notre narrateur qui nous fait ainsi revivre une partie de son enfance. Mais le choc
psychologique le plus important viendra quand des vues de Boiseau, le village de ses
jeunes années, se présenteront à ses yeux.
« …On peut parler si tu veux des commerçants qu'il y avait
ici, des commerces car, à Boiseau, la rue du commerce c'était véritablement la rue du
commerce. En allant du bas en haut, il y avait deux cafés en bas, celui de l'Etier et
l'autre qui était au Chat Qui Guette. En remontant la cale, il y avait une épicerie qui
était tenue par une vieille fille qui s'appelait Charlotte, elle était au milieu de la
rue de la Douane qui descend à pic où habite Lydie Gilard. C'était vraiment peu de
choses, il y avait des sacs de lentilles, sacs de sel, sacs de son, quelques
allumettes - quoique celles-ci étaient plutôt vendues au bureau de tabac -, un peu de
café en vrac, peu de choses et puis surtout ce qu'elles vendaient les épicières à
l'époque, c'était du beurre. Elles allaient chercher le beurre au marché et le
revendaient. C'était à peu près le gros de leur commerce. En remontant y avait un
marchand de vélos qui était où habite Guilleux actuellement, un réparateur de vélos
plutôt. Après en face de chez moi, il y avait un sabotier, c'était le grand-père de
ma femme, un Denaud qui faisait des sabots. Il est mort relativement jeune et sa femme
après a fait de la charcuterie. A l'époque la charcuterie c'était véritablement de la
charcuterie de campagne, elle achetait un quart de cochon et faisait charcuterie,
saucisses et autres qui étaient cuites d'ailleurs dans des « casses ». Les casses sont
des plats en terre, de forme plate qui étaient mis à cuire dans le four du boulanger,
lorsqu'il avait fini sa fournée, on y mettait les casses de charcuterie qui cuisaient
là en fin de chauffe. D'ailleurs c'était une habitude, en fin de chauffe, on allait
porter des pommes cuites, on allait même porter des poulettes qu'on faisait cuire comme
ça. Tu avais, je te dis, des plats en terre vernissée dans lesquels on mettait le
poulet avec du beurre à l'intérieur etc. On mettait la casse et alors là on pouvait la
prendre avec un bâton, quelquefois avec la pelle du boulanger, mais le plus souvent en
poussant avec un bâton et bien des cuisines étaient faites au four du boulanger.
Pour continuer en montant il y avait le bureau de tabac qui faisait également café. A
l'époque le bureau de tabac distribuait obligatoirement les timbres et même les timbres
fiscaux, ce qui n'existe plus maintenant. C'était assez extraordinaire parce qu'à
l'époque on vendait encore la chique. La chique c'est le tabac à chiquer, c'était … une
sorte de truc allongé qu'on appelait une carotte. C'est d'ailleurs pour ça que les
bureaux de tabac modernes sont marqués par une carotte rouge. Il y avait alors beaucoup
d'anciens marins qui chiquaient et qui achetaient leurs … 30 grammes de chique et se
mettaient ça dans le bec en arrivant et pour économiser le truc quand ils mangeaient ou
qu'ils buvaient, ils crachaient leur chique et la remettaient dans le devant de la
casquette. Tu sais, la casquette marine, on mettait la chique là et puis on la
reprenait. Ah ben ! C'était comme ça et on la reprenait jusqu'à ce que le jus soit
complètement épuisé.
Autrement il y avait quelque chose que j'aimais bien quand j'étais gosse, lorsqu'il y avait des
pièces fausses, parce qu'à l'époque il y avait encore des pièces en argent qui pouvaient être
remplacées par du plomb. Quand on trouvait une pièce fausse, elle était clouée sur le comptoir
pour que ça serve d'exemple et là, je me rappelle, à Boiseau, tu avais une dizaine de pièces qui
étaient clouées sur le comptoir.
C'était pas compliqué parce que les pièces d'argent étaient relativement rares et les gens n'avaient pas l'habitude du
poids comme on a pour les pièces actuelles. Alors là les français ne s'emmerdaient pas, ils prenaient une pièce normale,
faisaient un moule en plâtre fin et puis coulaient du plomb dedans. On arrangeait ça un petit peu, on le paraît un peu.
Les contrefaçons étaient absolument grotesques mais ça passait.

|
En remontant toujours il y avait le boucher. Il n'avait pas le débit qu'il a maintenant. Pratiquement on avait de la
viande dans le courant de la semaine mais pas beaucoup, on consommait plus de poisson que maintenant et il y avait
beaucoup de gens qui allaient à la pêche, entendons-nous bien, ce n'était pas la pêche à la ligne, c'était la pêche au
carrelet et surtout la pêche à l'épervier. C'était une chose à voir parce que ça pesait lourd ce truc-là. Je ne sais pas
comment ils pouvaient manier ça à bord d'une plate et je sais que mon grand-père pêchait à l'épervier et ramenait
énormément de poisson. Le poisson pêché comme ça n'était pas vendu pour deux raisons : la première c'était
évidemment que c'était strictement interdit mais ça les gens s'en foutaient un peu et surtout ç'aurait été très mal vu de
vendre le poisson qu'on avait pêché. Ce qui arrivait surtout c'est que la pêche était répartie, il y avait une sorte de
répartition de la pêche entre les voisins, à charge de revanche. Les gens allaient pêcher et redistribuaient leur poisson.
Il y avait un esprit communautaire sans le mot qui prévalait. Les faits étaient là. D'ailleurs en parlant de ça, je me rends
compte d'une chose c'est que j'ai oublié complètement ce qui était le plus important pour moi dans les commerces de
la rue, c'était le forgeron.
Le forgeron était mon grand-père. Il était installé ici, ici même, c'est-à-dire que tout le bas était la forge, les deux pièces
de devant constituaient la forge, derrière c'était le pressoir à long fût. La forge était dans cette partie-là avec le
soufflet, l'enclume et tout ça. Mon grand-père était en même temps maréchal-ferrant et il ferrait sur la rue. Il n'avait
pas de travail d'ailleurs, il ferrait à la main et avait un aide qui tenait le cheval. Les fers n'étaient pas comme
maintenant faits d'avance. Il recevait des lingots de ferraille et il formait le fer lui-même à la demande. Il fabriquait
donc un fer pour le cheval à X ou le cheval à Y. C'était du sur-mesure. Je crois d'ailleurs que c'était général chez les
maréchaux-ferrants. C'était son savoir-faire, il ferrait les chevaux, réparait les machines agricoles pour des sommes
absolument dérisoires et ce qu'il y avait de plus extraordinaire c'était que, comme la plupart des artisans locaux, il
n'était payé qu'une fois l'an pratiquement après les vendanges.

|
C'était ainsi et il n'y avait pas que les forgerons, tous
les artisans étaient dans le même cas. Alors, évidemment, ils vivotaient
toute l'année avec ce qu'ils cultivaient, ce qu'ils ramassaient. Y avait
beaucoup d'autosuffisance. On mangeait beaucoup les animaux de clapier,
les poules … les légumes et tout ça. Le vin était fourni. Pratiquement les
grosses dépenses qui étaient faites, c'étaient surtout des dépenses extérieures,
les impôts, l'immobilier… Enfin surtout il y avait un roulement, ils avaient
un fonds de roulement. C'est ce qui explique parfois la découverte de certains
trésors dans les maisons, c'est que pratiquement il n'y avait pas de compte
en banque, tout l'argent était conservé dans les maisons, il y avait les
caches, les caches qui n'étaient pas toujours connues, parfois oubliées,
c'est ainsi que l'on retrouve dans certaines vieilles maisons des pièces
d'or ou d'argent. Mais on thésaurisait surtout les pièces d'or. Les pièces
d'argent et surtout les billets de banque qui étaient relativement rares
n'étaient pas thésaurisés car les billets se dévalorisent et se conservent
mal. Alors ce qu'on gardait c'était l'or et l'argent et on utilisait pour
le courant la monnaie de bronze.
En face le boucher, il y a eu plusieurs commerces. C'étaient les tantes de Henri Hervé,
elles ont d'abord fait de la charcuterie, c'était classique et après elles ont vendu du
lait, c'est-à-dire qu'elles allaient chercher le lait dans les fermes, la plupart du
temps, c'était en bas, à la ferme de la rue. Elles avaient ce qu'elles appelaient une
“cariquelle”, un machin à 3 roues et puis elles descendaient avec leurs 3 bidons.
Tu sais, c'était vraiment le gagne-petit le commerce. Ils ne pouvaient pas vivre avec
ça, mais ça permettait d'aider.
Après il y avait la coopérative qui existait dès la fin de la guerre de 14. C'était la
coopérative de Loire-Inférieure, à ne pas confondre avec celle d'Indret. C'est une boîte
qui marchait, c'était une très belle épicerie et qui fonctionnait. Elle a duré jusqu'à
10 ou 15 ans et a disparu avec les grandes surfaces. Toujours en remontant, c'est pour
te dire, le nombre de commerces qu'il y avait, toujours en remontant, de l'autre côté de
la rue, il y avait une autre petite épicerie, mais alors minuscule qui vendait comme
celle de la rue de la Douane pas grand chose et qui vivotait avec ça.
Après il y avait la boulangerie. La boulangerie qui, tout de suite après la guerre de
14, chauffait encore au bois. Et il y avait sur la place du maréchal Leclerc qui
s'appelait à l'époque la place du Dîne-Chien, d'énormes « mouches » de bois, c'était le
terme qu'on employait, c'étaient en réalité des « mouches » d'épines, le boulanger
allait tous les jours chercher son bois à brûler et chauffait avec de l'épine. Ca devait
être un sacré boulot d'ailleurs.
Et puis après, il y avait la coiffeuse. C'était une veuve qui était sourde comme un pot.
Quand on était mouflets, on allait là-bas. Elle nous disait comme ça :
- Qui qu'tu veux mon fis ?
Tu lui expliquais : Je voudrais que vous me coupiez les cheveux mais alors bien quoi,
bien dégagé là, avec la raie dans le milieu et puis que ça soit à la mode quoi !
- Ouais ! ouais, t'inquiètes pas !
Alors tu sortais de là, t'étais coupé au bol. Et à la fin , c'était :
- Veux-tu une friction ?
- Ah non, maman va me la faire.
- Bon, d'accord, je vais te mettre un peu de « vétivert ».
Alors t'étais inondé, tu sortais avec ta machine en boule de billard et tu sentais. Tu
sais le vétivert, c'est un parfum assez violent, ah ! tu savais que tu sortais de chez
la coiffeuse. On l'appelait la « fratresse » d'ailleurs, l'origine du mot c'était
frater. Le frater c'était autrefois le sacristain et le sacristain, dans ses
attributions, était souvent coiffeur, il coupait les cheveux. De frater on a fait
fratresse au féminin ».

|
Le tour des commerces de la rue du même nom effectué, René Mocquard aura une conclusion assez pertinente sur les conditions
de vie de ces anciens commerçants qui, en fait de vivre, se contentaient de survivre en ne faisant que … vivoter :
« ... ce qui m'effare un peu, c'est le peu de volume qu'ils avaient au fond parce qu'ils
travaillaient pour rien quoi pratiquement. Tu te rends compte, une petite épicerie tenue par une vieille personne
vendant du sel, des lentilles un peu de café, du beurre, un peu de mercerie aussi … mais il y avait des trésors aussi
là-dedans … ».
La fatigue interrompit à ce moment notre interlocuteur. Ce ne sera que douze
jours plus tard que l'on pût reprendre cet entretient. Le même fil conducteur,
les sempiternelles reproductions de cartes postales, liens entre hier et
aujourd'hui, servira de trame à l'évocation des souvenirs boiséens. C'est
l'église de St Jean qui apparaît cette fois-ci en premier :
« Y a pas grand chose à dire sauf que la
Municipalité qui nous avait précédé a supprimé au fond ce qui était assez
caractéristique, c'était ce qu'il y avait à l'arrière de l'église. Il y avait
une croix et dans le bas il y avait ce qui ressemblait un peu à un autel.
C'était un cube de maçonnerie qui ressemblait à un banc sur lequel il devait
y avoir peut-être bien la Vierge et l'Enfant mais je ne m'en rappelle plus.
Ce truc-là, d'après ce qu'on m'en a dit, ça s'appelait le dépositoire et
avant d'entrer à l'église on déposait lors des enterrements le cercueil là,
avant d'entrer à l'église. Pourquoi ? Il devait y avoir certaines prières qui
se faisaient au-dehors de l'église. Il y avait la place de mettre un cercueil.
Il y a quand même dans le haut du chœur de l'église des
figures grimaçantes! Des figures grimaçantes qui camouflaient ce qu'on
appelait des sablières. Il me semble que ces têtes-là doivent être assez
anciennes.Ca ne présente peut-être pas un gros intérêt. C‘est comme la
chapelle de Bethléem … Cela dit, elle est bien mais enfin sans plus. Elle est
dans un triste
état. D'ailleurs je t'avais parlé l'autre fois d'une source miraculeuse … … …
Dans les grandes rues de St Jean et de Boiseau, il y avait quelque chose de particulier qu'on retrouvait dans à peu près
tous les villages, c'était la rue qui était encombrée par des jardins qui étaient devant les maisons. La plupart ont disparu,
c'étaient d'ailleurs des restes d'escaliers extérieurs parce qu'autrefois les escaliers étaient en pierre et en dehors de la
maison. Les escaliers de pierre ont été supprimés et ils ont gardé les jardins. Il y a aussi quelque chose qui n'existe plus
maintenant, ce sont toutes ces marches qui entraient dans les maisons où, à la belle saison, les gens restaient pour
discuter le coup jusqu'au coucher. Cela a été pratiquement supprimé après la deuxième guerre mondiale, mais moi je
me rappelle lorsque j'étais gosse, il y avait des gens tout le long. Alors, ou on se mettait sur des bornes de pierre ou on
sortait les chaises et on restait à discuter le coup jusqu'à ce qu'on aille se coucher.
………

|
Voilà le bac du Pellerin. Là, c'était un des premiers bacs
qui aient fonctionné parce que moi je n'ai pas connu celui-là. J'ai
simplement connu les bacs qui étaient les « roquiots » qui faisaient le
service de Trentemoult à Nantes. Alors après il y a eu simplement le passage
d'eau. Longtemps ils ont fait le taxi entre Nantes et Trentemoult. Pour en
revenir aux bacs, pas grand-chose à dire sinon que c'était assez folklorique.
Je me souviens qu'à bord, il y avait trois bonshommes quoi ! Le chauffeur-
mécanicien, le patron qui était pilote et puis le matelot. Alors évidemment
le soir, malheureusement il faisait chaud. Je me rappelle d'un patron qui,
quand il était à la barre, disait :
- En douceur
Quand il avait fini de dire en douceur il rentrait, bang, dans le ponton en
direct.
- Nom de Dieu ! Et puis, ça restait comme ça.
On retrouvait souvent la charrière du côté de Couëron, surtout le soir.
Mais il semble alors qu'au Pellerin, il y a eu un bateau
qui s'appelait le St Julien, ce serait à vérifier ça, et qui fonctionnait
avec des câbles. Ca, c'est à vérifier hein ! Ce bateau, c'était un amphidrôme
comme ceux qui sont là. Il fonctionnait évidemment à vapeur et s'appelait le
St Julien. Il fonctionnait entre Le Pellerin et Couëron. Il faut aussi
évoquer les abeilles, c'était une sorte de petit paquebot à vapeur qui
faisait en principe le service de Nantes au Pellerin et qui s'arrêtait à
Chantenay, Haute-Indre, Basse-Indre, Indret, Couëron. Oh les premières
abeilles partaient à 5 heures du matin et finissaient à 10 heures le soir.
Ils faisaient en même temps le transport de marchandises et la poste. Et ça
fonctionnait très bien jusqu'à, pratiquement au début de la seconde guerre
mondiale. A côté de l'abeille proprement dite, il y avait ce qu'on appelait
le « Ville de Nantes ». Le « Ville de Nantes », c'était un bateau un peu plus
grand qui ressemblait d'ailleurs au malheureux St Philbert et qui faisait
l'aller-retour de Nantes à St Nazaire avec cette particularité qu'il n'avait
pas d'horaire fixe. Il descendait et repartait avec la marée. Il devait
s'arrêter à Basse-Indre, au Pellerin, et à Paimboeuf. Il faisait le transport
de voyageurs et aussi le transport de marchandises, surtout le transport de
marchandises. Pratiquement il jouait le rôle que jouent actuellement les
SERNAM et autres. Il ne faut pas le confondre avec le « Ville de Nantes » à
roues, c'est-à-dire celui qui a fonctionné tout de suite après la première
guerre mondiale et qui a été remplacé ensuite par un bateau plus souple à
deux hélices qui a fonctionné pratiquement jusqu'au début de la seconde
guerre mondiale. Je crois même qu'il a fonctionné pendant la guerre.
C'étaient des bateaux qui étaient relativement robustes avec des machines à
vapeur classiques. Nous les mouflets, on admirait ça parce que c'était le
grand truc, on était à l'aise dedans. A bord, il y avait deux classes, la
première à l'avant, tu avais les embruns mais pas les escarbilles et il y
avait la deuxième classe derrière et là, ben tu récoltais les escarbilles.
C'était aussi confortable qu'un car et puis c'était très agréable. Il n'y
avait que les aléas du mauvais temps.………
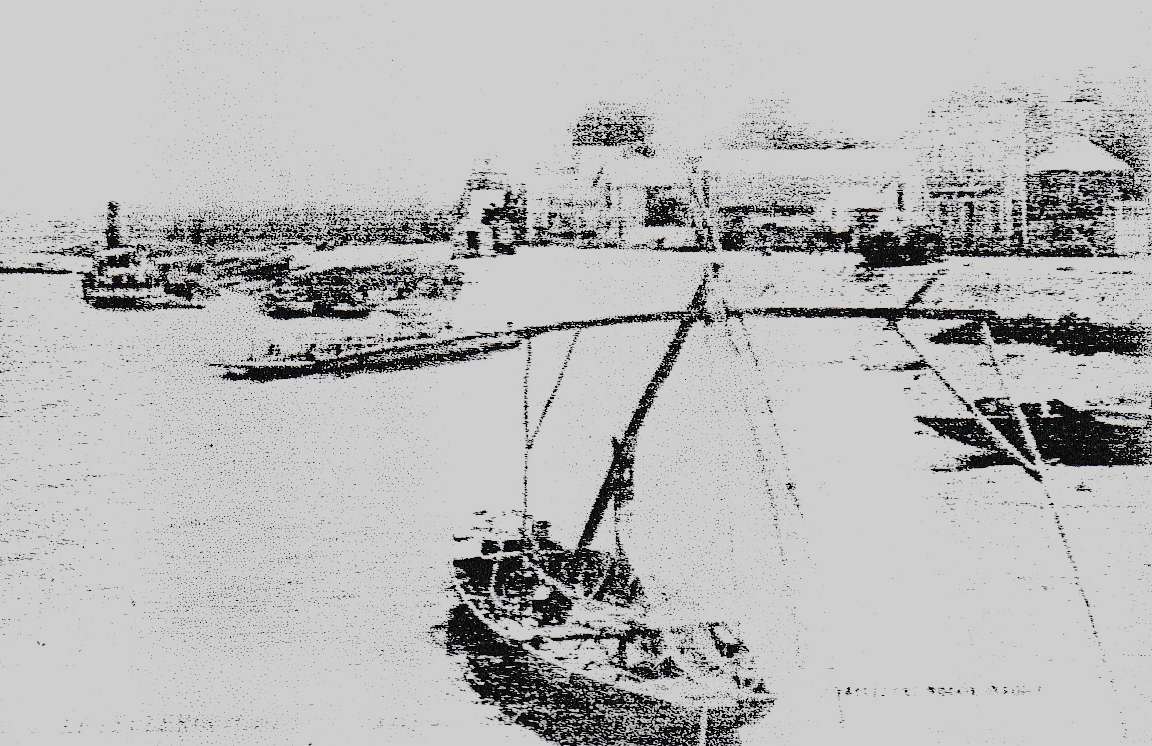
|
On voit également une toue à aloses, c'étaient des toues plates sur
lesquelles était installée une sorte de trébuchet. Le gars tendait son filet,
c'est-à-dire qu'il descendait le filet dans l'eau et restait derrière la toue
tenant dans les mains des ficelles qui rejoignaient le filet et quand il
sentait que le filet vibrait, il déclenchait le contre-poids, le filet se
levait et l'alose était pêchée. Les gens restaient là quelquefois des heures
entières et ne relevaient que lorsqu'ils sentaient une vibration.
Cette toue devant Le Pellerin n'est pas loin de la place du Port-Brutus.
C'est surtout intéressant à cause du nom. Port-Brutus étant le nom du
Pellerin pendant la Révolution parce qu'ils avaient débaptisé tous les noms
du coin. Ce qui était assez extraordinaire, c'est que les gens se trompaient
aussi bien au point de vue date qu'au point de vue lieu. Ils commençaient
leur acte d'état civil le 3 septembre 1794 et puis tout d'un coup ils
disaient :
- Bon Dieu, je me suis trompé
Et puis alors ils mettaient … voyons septembre c'était vendémiaire. Enfin,
bref, ils mettaient le 2 vendémiaire. Ils écrivaient aussi parfois Monsieur,
rayaient soigneusement et inscrivaient « le citoyen ».
Après cette petite incursion au chef-lieu de notre canton, nous nous trouvons
ramenés dans notre bourgade tout près de la limite entre St Jean et La
Montagne :
« … Ah oui ! Les carrières qui
étaient au bas du Chat Qui Guette. Alors moi, j'en ai
connu trois, il y avait celle qui était du côté de La Montagne, en bas de la Garenne, il y en avait une qui était derrière le
garage actuel et une autre qui était en remontant la rue des remparts derrière les maisons qui ont été construites, la
dernière qui a fonctionné, c'est celle qui était derrière le garage. Ca fonctionnait d'une façon strictement artisanale.
Les carriers essayaient de débiter les pierres au pic. On creusait à la barre à mine un trou de mine, on mettait un peu
d'explosifs dedans, les gars se barraient et puis on bloquait la circulation. Alors c'était « A la mineaout », c'était le
terme consacré « Attention à la mineaout ». Tout le monde arrêtait et bang, ça sautait. Il y avait les cailloux qui
tombaient et puis on les ramassait. La plupart du temps les cailloux étaient triés à la fourche. C'était un travail de
romain et les gros cailloux étaient cassés à la massette par les carriers qui passaient leurs journées assis sur leur
derrière. Ils tapaient sur le rocher de façon à avoir à peu près un granulé. Ce n'était pas du très bon rocher,
uniquement comme blocage sur les routes.
Elles ont dû arrêter peut-être bien dans les années 30. C'est-à-dire à peu près quand le garage a été construit.
A côté il y avait là le pont, évidemment ça a beaucoup changé et juste à côté se trouvait une plate-forme et c'est là que
mon grand-père charonnait les roues. Pratiquement en face le café. On a vu longtemps qu'il y avait un cercle de
charbon de bois brûlé. Il mettait le cercle à chauffer et puis quand c'était bien chaud, avec des aides, il l'attrapait, le
posait sur la roue et puis comme il y avait de l'eau tout près il y avait les femmes qui étaient là, qui attendaient et qui
flanquaient l'eau dessus. En allant un peu plus loin par là, c'est-à-dire face au garage actuel il y a eu longtemps un
Tivoli où on faisait danser le dimanche. C'est une construction légère en planches et qui était couverte en toile. C'était
là-dedans qu'ils faisaient danser et le propriétaire du café, c'était un gars Delaunay, pour attirer les gens, avait acheté
une montgolfière et tous les dimanches d'été, il faisait monter sa montgolfière. C'est avant la première guerre
mondiale.
Le garage, à l'origine, c'était très simple,
tu sais il n'avait même pas de pompe à essence et à l'époque il me semble bien
qu'il tenait le café en même temps. Alors le Chat Qui Guette, c'était pas le
chat qu'on voit actuellement en porcelaine, c'était véritablement un tableau
qui était dehors. Il le refaisait périodiquement, un tableau qui représentait
un chat qui guettait une souris sortant d'un fromage. C'est de là qu'est venu
le Chat Qui Guette ».
Là s'arrêtera l'enregistrement de nos entretiens, la bande
magnétique est arrivée à sa fin. René Mocquard nous a fait revivre avec sa
verve coutumière quelques moments du passé de notre commune, le tout
accompagné parfois de petits commentaires qui ne rendent que plus
croustillantes les anecdotes qu'il a su raconter. Qu'il en soit remercié par
ces lignes dont il est en fait l'auteur et que vous aurez eu plaisir, nous
l'espérons, à lire.


 Consulter la page sur le site d'histoire de St Jean de Boiseau
Consulter la page sur le site d'histoire de St Jean de Boiseau