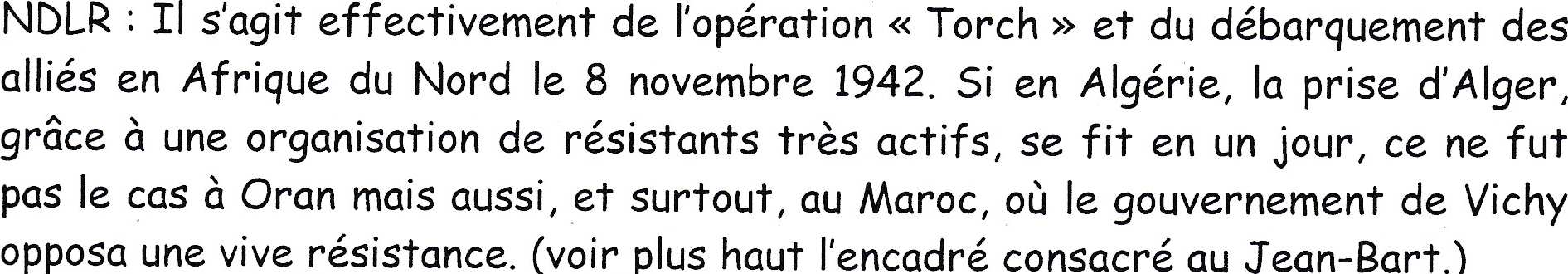cette époque j'avais des difficulté s à trouver un travail stable, et depuis
longtemps, j'étais attiré par
la mer ; c'est dans ce contexte que, je me suis engagé volontaire pour 3 ans dans la Marine.
Je suis incorporé le 13 août 1939 au 3me dépôt des équipages. Tous les jours nous voyions arriver les réservistes ;
l'encadrement n'y échappe pas. La guerre n'est pas encore déclarée mais déjà plusieurs tranches d'âge ont été
rappelées sous les drapeaux.
 |
Deux mois plus tard, les classes terminées, je suis convoqué devant l'officier supérieur qui me donne mon affectation
: ce sera la BAN de Rochefort, dans la branche des arrimeurs d'aéronautique. Arrivé sur place, ce sera les
cours de matelotage (apprentissage des nœuds et des épissures) et l'école de nage sur la Charente (maniements des
avirons et conduite de la chaloupe). Au bout de 7 mois d'instruction, je suis dirigé vers la BAN de Lanvéoc
Poulmic, près de Brest, et affecté à la 4ème Flottille de bombardement.
Nous sommes le 1er avril 1940. La France est en guerre depuis septembre 1939, et les nouvelles ne sont pas bonnes. A
l'affût des renseignements (à cette époque ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui), nous n'avons pas de quoi nous
réjouir : c'est ainsi que nous apprenons l'avancée des allemands en passant par la Hollande et la Belgique.
Contournée, notre ligne Maginot ne résiste pas. Pire encore : à Dunkerque, les anglais, après avoir essuyé de lourdes
pertes, sont retournés chez eux.
Si aujourd'hui, le 18 juin 1940 est devenu une date importante de notre Histoire, pour Paul et les autres occupants
de la base de Lanvéoc-Poulmic, ce n'est autre que le signal du grand chambardement.
Le 18 juin, l'ordre a été donné de quitter la base. C'est le désarroi complet. Nous n'avons plus de Commandement et
nous venons d'apprendre que le Gouvernement après s'être replié à Tours se trouve à présent à Bordeaux. Paul Raynaud,
le Président du Conseil aurait même démissionné.
Certains éléments ne se contrôlent plus et se mettent à tout détruire sur leur passage. Je pense que le libre accès à
la cambuse y est certainement pour quelque chose. Soudain, des avions survolent la base. C'est la panique, et la
D.C.A. entre en action pensant à un raid de l'aviation allemande. Ce sont, en réalité, des avions français. Par
bonheur, la méprise ne dure que peu de temps, l'erreur est vite décelée. Il y aura quand même quelques blessés.
 |
Le moment de grande panique passé, il faut s'organiser. On nous donne l'ordre de rassembler nos affaires le plus
rapidement possible. Valises, sac de marin, tout est rempli à la hâte. A l'exception de quelques uns
qui ont réussi embarquer dans les avions de la base, nous sommes dirigés vers le port de Brest tout proche. Parmi
ceux qui parvinrent à s'évacuer par les airs, un camarade du Pellerin, aujourd'hui décédé : Roger Tessier, le père
d'Alain.
Arrivés à Brest, par où peut-on partir ? Hors de question de prendre la route : l'ennemi est là. Nous sommes pris
dans une nasse. La seule issue c'est la mer.
Deux cargos de la Compagnie des Chemins de Fer sont réquisitionnés pour partir de Brest : le PlM 13 et le PlM 17.
Nous prenons donc la direction du port. Là, un spectacle de désolation nous attend la plupart des bâtiments de guerre
ne sont plus là. Nous l'apprendrons plus tard, 162 bâtiments de commerce ou militaires ont quitté le port, et les 14
bâtiments nëtant pas en mesure de prendre la mer se saborderont plutôt que de passer aux mains de l'ennemi.
Partout règne une ambiance de panique. Afin de ne pas livrer le matériel aux mains de l'ennemi les grues sont
détruites à l'explosif.
Il faut faire vite. C'est le PlM 13 qui le premier quitte le port et se dirige vers le sud, personnellement,
j'embarque sur le PlM 17. Un capitaine de corvette, l'un des rares officiers encore sur place, surveille
l'embarquement et pousse tout le monde à faire vite. les haut-parleurs du bord signalent le largage des amarres et le
départ imminent. Dans la précipitation des sacs tombent à l'eau ; tant pis pour les propriétaires : on n'ira pas les
récupérer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de mal de gars sont ivres morts. Ils ont trouvé dans l'ivresse le
courage qui leur fait défaut. L'alcool aidant c'est la violence qui prend le pas ; ce n'est qu'engueulades et
bagarres. Pire encore, certains sont dans un tel état qu'ils n'ont plus la force ou la lucidité pour embarquer. Ils
sont immédiatement faits prisonniers par les Allemands, arrivés dès le lendemain.
Enfin, avec toute la puissance de ses machines le cargo s'arrache du quai et nous partons. Nous n'avons pas fait cent
mètres que nous rentrons en collision avec un remorqueur. Sous le choc, celui-ci fait un demi-tour sur lui-même.
L'ëchange verbal est vif, mais l'heure n'est pas aux discussions et nous filons.
Voici la pointe Saint-Mathieu. J'aperçois le sous-marin Surcouf équipé de son hydravion ; il est au mouillage. Il
disparaÎtra quelques temps plus tard de façon mystérieuse (NDLR : il sombrera le 18 février 1942, heurté par un
cargo, près de Panama). Nous croisons également plusieurs bateaux de pêche, chalutiers et caseyeurs. Ils ont tous le
drapeau français bien apparent et certains arborent fièrement une pancarte où il est écrit « On les aura ». Ils nous
font des grands saluts les larmes aux yeux... Tiens voici venir le cuirassé « Paris » qui nous double par bâbord. Que
de monde ! Je saurai plus tard qu'ils faisaient partir de tous ces bâtiments qui ont quitté Brest depuis le matin
 |
Mais où allons-nous ? Nous sommes sans aucune information ! Chacun s'interroge. Nous sommes tous silencieux, enfermés
dans nos pensées qui sont loin de baigner dans l'optimisme. Depuis la veille tout est allé très vite. Voici le temps
de la réflexion...
Des côtes apparaissent à l'horizon. Quelles sont-elles ? Ce sont les côtes anglaises : c'est là notre destination. Au
soir du 19 juin, nous arrivons dans le port de Plymouth. Mais avant d'accoster il faut longuement parlementer avec
les autorités anglaises.
Enfin, nous pouvons débarquer. Cela ne se fait pas dans l'anonymat. Nous sommes la curiosité de la population locale
rangée des deux cotés de la route. Au bout du chemin, une salle nous accueille. Nous pouvons y déguster des biscuits
de guerre avec du thé. Le lendemain matin, un pianiste vient nous interpréter quelques airs, histoire de mettre un
peu d'ambiance et chasser la déprime générale. Mais le cœur n'y est pas et le moral non plus. Nous prenons le train
pour Londres puis nous sommes dirigés vers l'ambassade de France. Premiers-maÎtres et MaÎtres Principaux tentent de
rétablir un semblant de discipline et nous invitent à marcher au pas cadencé, « une-deux, une-deux ». Sans grand
succès. Il est vrai que l'allure hétéroclite qui est la nôtre n'incite pas à la discipline (Souvenez-vous qu'à
l'embarquement, certains ont perdu leurs vareuses, d'autres leurs bâchis). Notre seule volonté : retourner au Pays.
A l'ambassade de France, nous essuyons une fin de non-recevoir. La France est occupée, il n'en est pas question. Le
nouveau président du Conseil, le maréchal Pétain, a demandé l'armistice avec l'Allemagne. Nous sommes atterrés.
Qu'allons nous devenir ?
Notre nouvelle destination sera Liverpool. Là, nous sommes emmenés vers le camp d'Antrée. Hébergés sous des toiles de
tente sur un hippodrome mis à notre disposition, nous attendons la suite des évènements avec en chacun de nous une
certaine angoisse sur notre devenir. Organisés en petits groupes, par affinités, nous nous adaptons ; chaque domaine
ainsi constitué est baptisé selon les goûts des occupants. Pour moi, ce sera : « Sam'suf fit ». Pour la bouffe, pas
de surprise, c'est toujours le même menu : biscuits de guerre et thé à profusion. Invité chez des anglais conviviaux,
je déguste sans grimacer des petits pois, à la menthe. En cet instant, malgré la gentillesse de mes hôtes, j'en
arrive à regretter les fayots de /'ordinaire du marin bien de chez nous.
 |
Voilà un mois que nous sommes là. Qu'allons-nous devenir ? Que nous réserve demain ?
Un beau matin, grand remue-ménage. Nous sommes confrontés à un choix. On nous propose deux possibilités : soit
rester en Angleterre, ou embarquer sur le « Royal Scotsmann » pour une destination encore non définie. Pour ce
deuxième choix, nous devons rédiger notre demande d'embarquement. Trancher pour l'une ou l'autre solution n'est pas
facile ; chacune d'elles est porteuse de beaucoup d'interrogations ; d'autre part, ces jours passés en commun dans
l'incertitude ont créé des liens d'amitié. Et ceux-ci sont encore plus forts dans ce contexte : «Qu'as-tu choisi ?»,
« est-ce bien la meilleur solution ?» ...
Pour ce qui me concerne le choix est vite fait : Partir ailleurs, à l'aventure, vers d'autres horizons, plutôt que
moisir ici à Liverpool.
Je ne suis pas le seul à avoir opté pour ce choix. Le bateau est plein à craquer. C'est un paquebot mixte d'une
compagnie anglaise, le « Royal Scotsmann ». A bord, il n'existe plus de hiérarchie : amiraux, généraux matelots et
hommes de troupe sont harmonieusement mélangés. Le navire passe le canal Saint-Georges. Quand à notre destination,
c'est toujours le mystère. Aucune informati on n'arrive jusqu'à nous.
Je me trouve à fond de cale avec mes camarades et chacun s'installe comme il le peut dans l'inconfort, mais avec le
secret espoir que cette situation ne durera que quelques jours seulement. Ce sentiment ne fait qu'ajouter à
l'angoisse qui ronge chacun de nous.
En pleine nuit, le paquebot change de cap et remonte semble-t-il vers le nord et ce, pendant deux longs jours. Il
nous est formellement interdit de fumer sur le pont afin de ne pas être repéré. A bord, c'est le silençe radio. Ne
pas savoir ce qui se passe augmente nos craintes.
Pourquoi ce changement de cap ? Pourquoi toutes ces consignes de sécurité ? Où sommes-nous ?
On nous laisse entendre que nous serons informés en temps voulu.
Soudain, le paquebot fait à nouveau un changement de cap et se dirige plein sud, et à bonne vitesse. Cette nouvelle
orientation n'atténue en rien notre appréhension.
 |
Enfin, à notre grand soulagement, au large des côtes portugaises, les haut-parleurs de bord se réveillent et se font
entendre pour nous annoncer notre arrivée à Casablanca pour le lendemain matin. le lieu de notre destination passe au
second rang dans nos esprits. le plus important est de savoir que nous arrivons quelque part.
Au petit matin du 18 juillet, les côtes marocaines se profilent à l'horizon et le port de Casablanca se précise au
loin sous le soleil levant. L'accueil, cependant, nous surprend un peu. Notre bâtiment, battant pavillon anglais,
est accueilli avec précaution : dès que notre présence est signalée, l'aviso « Elan » se porte à notre hauteur et
nous accompagne jusqu'au port ; de plus, deux sous-marins, en semi-plongée, nous observent et, cerise sur le gâteau,
deux contre-torpilleurs ont braqué leurs pièces de canon vers nous. Pourquoi un tel « cérémonial » à l'encontre d'un
allié ?
Nous le saurons très rapidement à notre débarquement.
Beaucoup de choses se sont passées depuis notre départ de Liverpool, mais le plus important et le plus dramatique
c'est, le 3 juillet, la destruction, par l'armée britannique, de notre flotte basée à Mers-el-Kébir. Lors de cette
attaque surprise, 1300 marins français ont été tués. La plaie est encore saignante et on comprend mieux, dans un tel
contexte les précautions déployées à notre arrivée. Navire ami ou ennemi ?
Bien que la chose ne fût jamais confirmée, nous aurions là l'explication à nos différents changements de cap depuis
Liverpool : Avant d'obtenir l'autorisation de débarquer à Casablanca, nous avons été l'objet de pourparler et de
négociations entre les anglais et les autorités françaises. Pendant plusieurs jours nous étions considérés, d'une
certaine façon, comme des monnaies d'échange avec des anglais retenus à Gibraltar.
Je l'ai dit tout à l'heure, tout au long de notre entrée dans le port, nous étions escortés de prêts par l'«Elan ».
Comme beaucoup de mes camarades je me trouvais au bord du bastingage sur la passerelle avant. Et là, j'entends
« Paul ! Ohé, Diquelou ! ». Sur « l'Elan », c'est Henri Bouteiller de la Montagne, qui me fait de grands signes
(Il était électricien à Indret et fut prêtre ouvrier). Je n'ai jamais réussi à le revoir par la suite.
C'est à cet instant qu'une bonne nouvelle nous est donnée : le 19 juillet, le cuirassé « Jean Bart », avec une seule
hélice, a réussi à quitter Saint-Nazaire avant qu'il ne soit trop tard Il est là devant nous dans le port de Casa.
Deux jours plus tôt, le 17 juin le lancastria, aura eu moins de chance. Chargé d'évacuer les soldats anglais et les
civils restés sur le sol français, il est pris sous les feux de quatre bombardiers nazis à sa sortie du port de
Saint-Nazaire. La malchance fit qu'une bombe tomba dans l'une des cheminées. le navire disparut dans les flots en 24
minutes, entraÎnant avec lui quelque 5000 victimes. Pour beaucoup ce naufrage est reconnu pour la plus grande
catastrophe maritime, même avant celui du Titanic qui connut, il est vrai: un autre impact médiatique.
 |
En finalité, les autorités françaises, convaincues que notre arrivée n'est pas une diversion en vue d'un éventuel
débarquement, donnent le feu vert pour qu'enfin tout le monde puisse poser son pied sur la terre ferme et ... avaler
avec grand plaisir notre « verre de rouge » ; chose qui ne nous était pas arrivée depuis notre départ de Brest.
Là, nous sommes dirigés, dans divers endroits, pour y être hébergés. Pour ce qui me concerne «j'atterris » dans une
école (en juillet il n'y avait pas de classes) à Sourd Djedid dans la banlieue de Casa, l'école « Bourgogne ». Nous
dormons à même le sol dans les classes, avec seulement comme matelas ... de la paille.
Tous les pensionnaires ne sont pas les bienvenus. Un soir, on entend : « Attention ! Un scorpion !».
C'est une belle débandade ; tout le monde sort en catastrophe. Un des anciens, plus avisé, connaÎt ce genre de
bestiole et le traitement à appliquer. Il attrape la bête, calmement, l'enveloppe de paille et y met le feu . Le
scorpion se sentant perdu se suicide en se piquant la tête. Ouf ! Au retour dans la salle, imaginez l'appréhension.
Chaque brin de paille a été examiné.
C'est pendant ce séjour à Casablanca que j'ai fait la connaissance de Marcel Cerdan.
Question : Le boxeur ?
Paul :Oui le boxeur, le champion du monde, le copain à Edith Piaf qui est
mort dans un accident d'avion en 49. Un chic type, très gentil et très simple.
Question : Et après.
Paul :Je ne reste pas longtemps à Casa ; environ 2 mois. En septembre 1940, je suis affecté à
la BAN de Karouba ; ce sont ensuite, les bases aéro-navales d'Agadir, de Kouribga en Tunisie, puis Lartigue tout près
d'Oran et enfin le 13 août 1942, retour à Casablanca et fin de mes 3 ans d'engagement..
J'ai tout de suite trouvé du travail sur place, comme facteur et ensuite, j'ai été muté à la poste de Rabat. Nous
avons alors envisagé avec Emma que je revienne au Pays pour nous marier et ensuite que nous retournerions à Rabat.
Nous y aurions fait notre vie au Maroc. les évènements nationaux et internationaux allaient en décider autrement : le
débarquement des américains au Maroc le 8 novembre 1942, je crois..
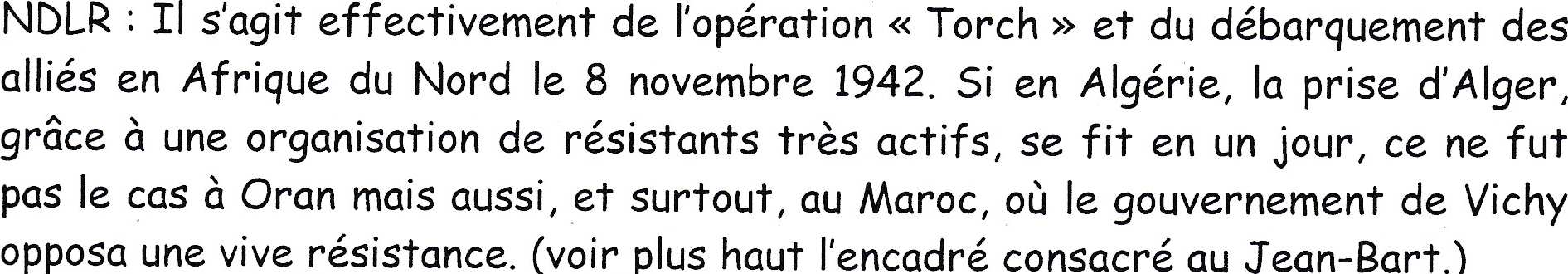 |
Me voici de nouveau appelé sous les drapeaux. Là encore, on se demande quel est notre rôle et dans *
quel camp sommes-nous. Qui est l'ennemi ? L'Allemand ? L'Américain ? Un collègue m'a certifié qu'il avait vu un
gars, un français, tirer sur un Américain, alors que celui-ci : sensé venir nous délivrer, lui tournait le dos et
n'était nullement agressif. Je te le dis, c'était complètement fou. A Rabat, des français, avec l'aide des marocains
avaient dressé des barrages pour freiner l'avancée des Américains.
Un nouveau choix se présente : rester appelé ou m'engager. la deuxième solution est financièrement plus avantageuse,
même je dois rester plus longtemps. C'est pendant cette période que suis nommé quartier-maÎtre arrimeur. A ce propos,
il y a bien longtemps que j'ai touché à un cordage. La quasi-totalité de mon temps, je l'ai passée comme maÎtre
d'hôtel au mess des officiers.
Je reviens en France sur le « Duquesne », destination Toulon. De là, je rejoins la base de Cuers où un avion Catalina
m'emmène à Cognac, ma nouvelle affectation. En cette période, les Allemands tiennent encore la poche de Royan et nos
bombardiers de la 4me E.B. partant de Cognac les pilonnent constamment. Je ne reste que très peu de temps à Cognac et
je suis dirigé vers Hyères.
Le 1er août 1945, je retourne à Saint-Jean pour y épouser Emma. Et cette fois sans contretemps. Elle m'accompagne à
Hyères, jusqu'à la fin de mon engagement.
 |
Le 29 septembre 1945, je suis démobilisé et je réintègre la vie civile. Le 24 décembre je rentre à Indret
où là enfin
je peux mettre en pratique
mes connaissances d'arrimeur. Au premier décembre 1978, je fais valoir mes droits à la
retraite pour vivre avec Emma au pied de notre moulin.
Malgré les années, je me souviens encore de ces années troubles où chaque jour nous apportait son lot de points
d'interrogation.
Cependant je ne me plains pas. Je n'ai jamais connu la misère. J'ai côtoyé de braves gens. La vie a su me protéger ;
bien des camarades n'ont pas eu cette chance.
Voilà, après 70 ans, raconté pour nous par Paul, ces moments troubles que notre pays a vécus.
C'est l'amour de la mer qui avait amené Paul à s'engager dans la Marine. Hélas pour lui, le destin allait en décider
autrement.
Pendant ses périodes de 3 et 2 ans 1/2 d'engagé volontaire, il ne comptabilisera pas plus que 5 mois et 11 jours
« de service à la mer ».
Cela ne l'a pas détourné de cette attirance vers la mer ; Il est depuis plus 25 ans le fringuant porte-drapeau de la
section locale du Pellerin de l'Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants.
Souhaitons-lui de brandir encore longtemps ce bel emblème.