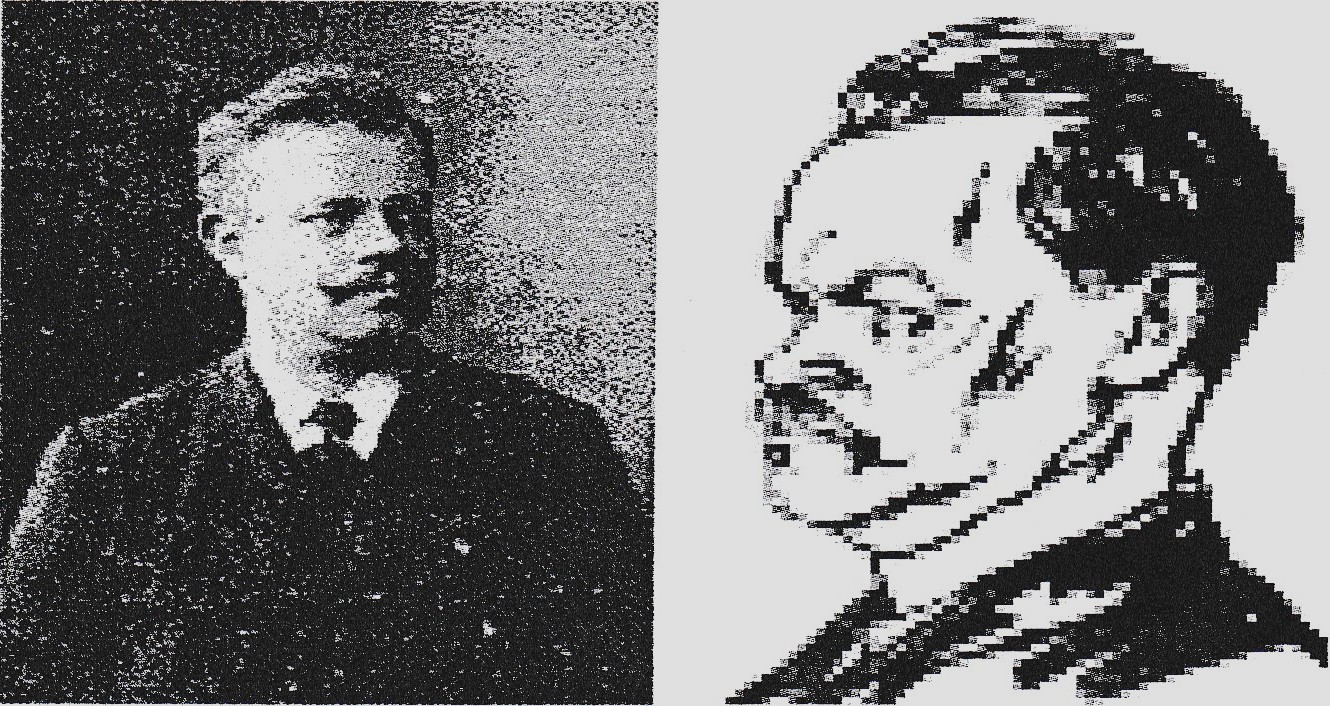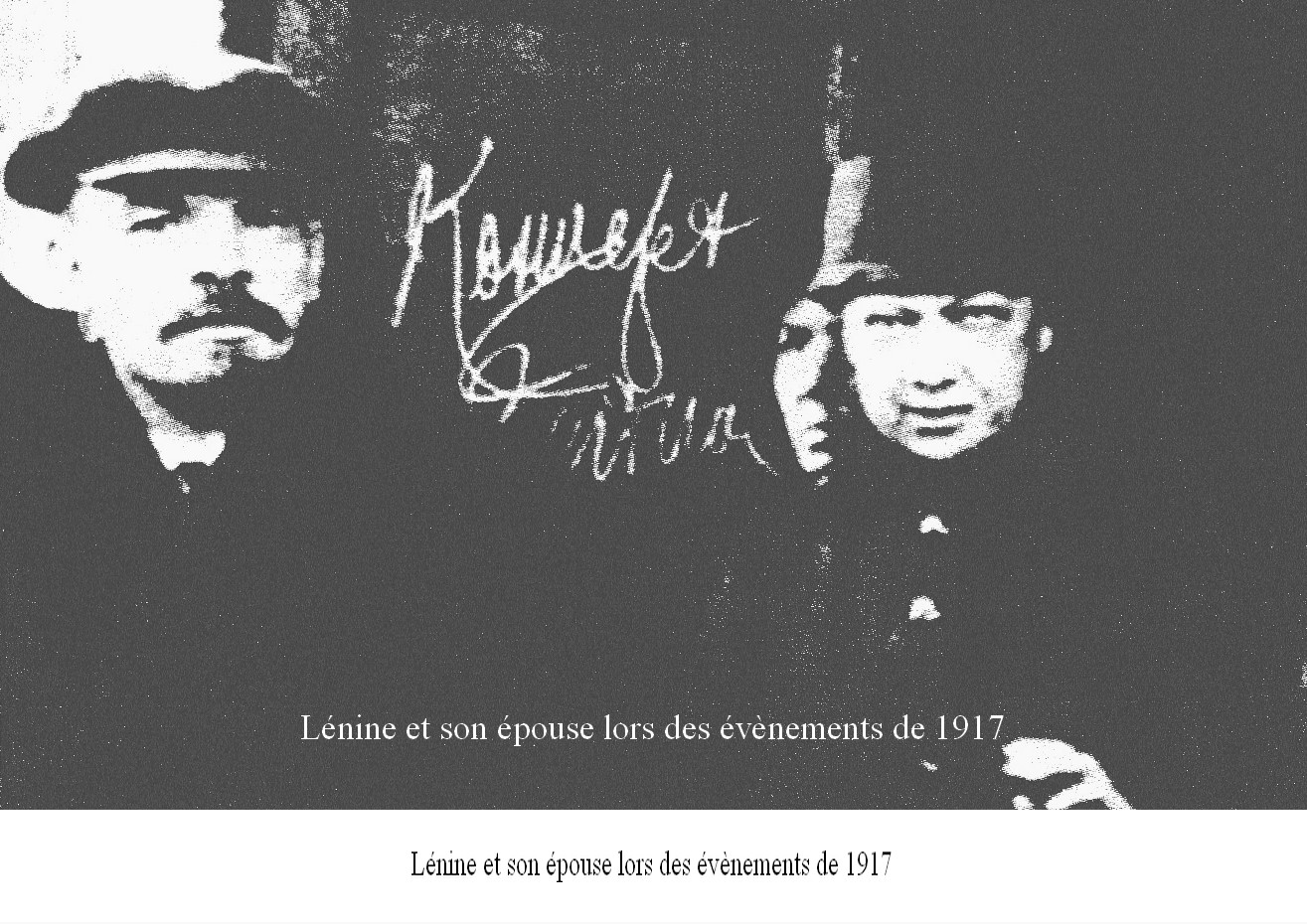1905 ! Est-ce le fait du hasard ! Avec la naissance de S.F.I.O., nous voyons apparaître les
premiers mouvements ouvriers dans les établissements de la marine.
Depuis cinq ans les socialistes ont tenté de fédérer les différents courants d'idées qui l'animent. Il n'est pas
chose facile de trouver une structure commune aux marxistes de Jules Guesde, aux anarchistes, aux communistes et
autres indépendantistes. S'ils ont abouti à cette union et trouvé un consensus, il faut bien le dire, ces différents
courants précités ne sont pas morts.
Comparativement aux carrières de Roche-Ballue, aux Forges de Basse-Indre, aux Ateliers de Pontgibaud à Couëron ou aux
tout jeunes Ateliers des Côteaux, né avec la création du canal de la Martinière, l'Etablissement d'lndret est de loin
le plus calme. Etablissement militaire, structuré comme un régiment, ce n'est certes pas le creuset idéal pour
fomenter un conflit social. Et pourtant ... Il suffit quelquefois d'une simple étincelle pour embraser tout un
secteur.
L'étincelle, c'est de Brest la Rouge qu'elle viendra.
A l'occasion d'une fête syndicale, Victor Pengam, un ouvrier du port, tient une conférence antimilitariste, insulte
les officiers, l'armée et la Patrie. La réaction ne se fait pas attendre, et le vice-amiral Pephau, préfet maritime,
met l'orateur « à pied » pour une durée d'un mois. Cinq ouvriers, solidaires de Pengam, demandent lors d'une réunion
publique qu'on leur applique la même sanction. Le vice-amiral se fait un devoir d'accéder à leur désir. Il n'en faut
pas plus pour mettre le feu aux poudres.
Cette sanction est largement diffusée dans les différents établissements.
A Indret, le 14 novembre 1905 au matin, juché sur un rocher au pied du coteau de La Montagne, tout au bout de la
digue qui relie cette commune à l'île d'lndret (c'est le seul accès à l'établissement pour les ouvriers venant du
sud. La digue de Boiseau ne verra pas le jour avant 1910), Jean Chuniaud le leader syndicaliste, conseiller municipal
de Saint-Jean-de-Boiseau, harangue les ouvriers qui se rendent au travail. Pour la circonstance il a reçu l'appui
d'Yvetot, le nouveau responsable national de la Bourse du Travail ; il remplace depuis peu Fernand Pelloutier, l'un
des initiateurs de cette nouvelle structure, décédé 4 ans plus tôt de la tuberculose.
Une grève à Indret ! En voilà une surprise ! Evidemment cela ne va pas sans une certaine effervescence, bien
inhabituelle en ces lieux.
Jean va avoir 13 ans dans un mois. Il fréquente la classe de Monsieur Olive, l'instituteur de
l'école primaire de La Montagne. D'un naturel curieux, il se sent irrésistiblement attiré par l'événement. En se
faufilant, il tente de s'approcher au plus près des manifestants. Il avale littéralement les paroles enflammées
de l'orateur et se sent transporté par sa faconde. Il ne tarit pas d'enthousiasme à l'égard de ce tribun venu
d'ailleurs.
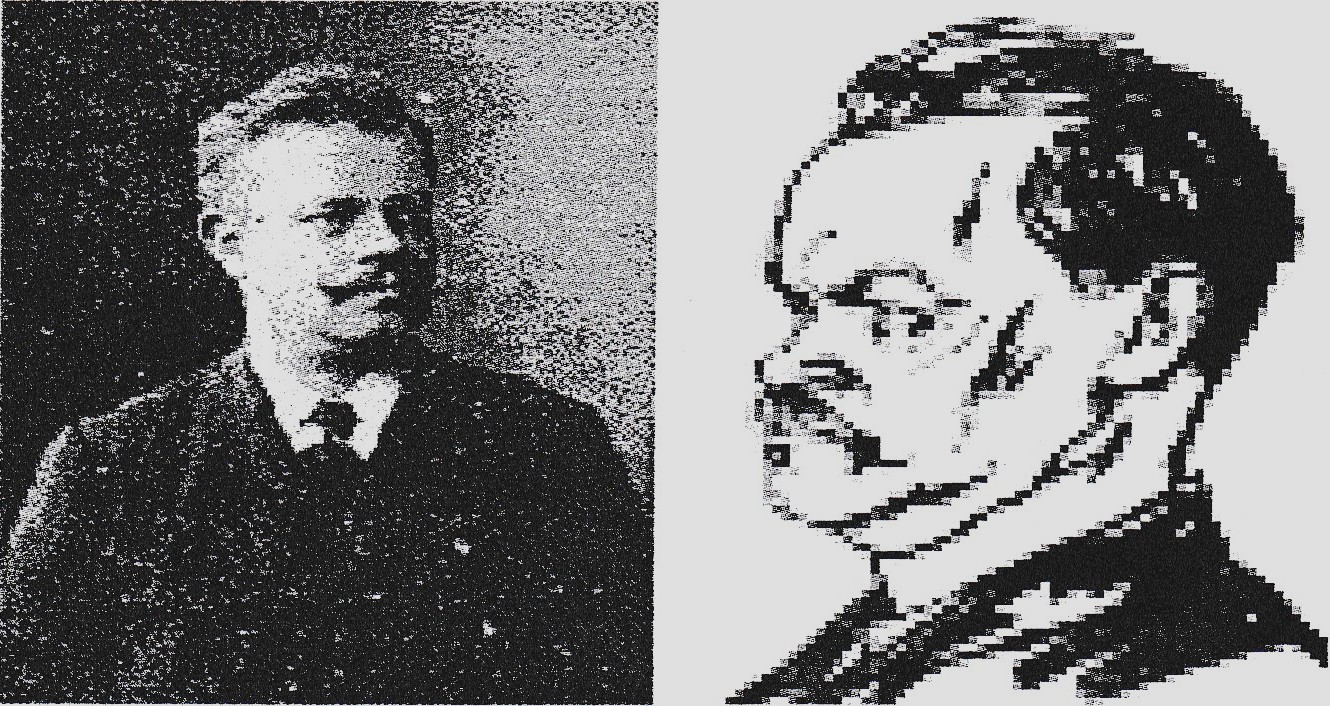 |
Hélas, Yvetot part dès le lendemain et avec lui l'élan revendicatif des meneurs s'éteint comme feu
de paille.
Il faut le dire, les épouses ne sont pas totalement étrangères à cette extinction prématurée de cette flamme
prolétarienne ; hormis le manque à gagner, leurs hommes ont prolongé la manifestation dans les estaminets du coin -
le « Chat qui guette » ou au café Rafrais à La Montagne, entre autres - et le retour au foyer ne s'est pas fait sans
mal. L'une d'entre elles est même intervenue auprès du capitaine Gerbais, commandant du peloton de gendarmerie, afin
qu'il oblige son homme à réintégrer l'usine.
Jean en est terriblement déçu et reste sur sa faim. Ce n'est pas le cas de Justine, sa mère, qui a appris sa présence
sur les lieux et qui, bien que l'ayant sévèrement réprimandé, n'en dira rien à son père.
Malheureusement, malgré le silence maternel, sa présence sur les lieux en ce 14 novembre est parvenue aux oreilles
paternelles. La sentence est on ne peut plus ferme : consigné à la chambre dès la sortie de l'école et ce, jusqu'au
retour du père. Le dimanche en présence de ce dernier, la consigne reprend toute sa rigueur.
Depuis ce 14 novembre, Jean est resté sur sa faim. Dans ses lectures il avait pris connaissance de ce que pouvait
être un conflit social. Ce qu'il a vécu ce jour-là n'en est qu'une pâle illustration.
A Couëron, le mouvement syndical va prendre une autre dimension.
Au début de l'année 1906, le jeudi 17 janvier, à Pontgibaud, les ouvriers se mettent en grève et demandent à toucher
les dividendes de la prospérité de l'entreprise. Ce mouvement durera plus de 15 jours et mobilisera l'ensemble de la
classe ouvrière de la Basse Loire.
Pour Jean, la consigne à domicile n'est toujours pas levée. Toutefois, le temps passant elle s'est assouplie.
Le samedi matin, alors que sa mère s'est absentée, Jean s'enfuit par la fenêtre et file vers le bac pour rejoindre
les grévistes couëronnais et son ami Emile Hureau de deux ans son cadet. Cette escapade est de courte durée, mais
permet à Jean de se délecter quelques instants de cette ambiance qui l'attire.
Le lundi suivant, l'appel à l'action est trop fort. Accompagné de son inséparable ami Emile, il ne se rend pas à
l'école et retourne sur les lieux du conflit Le reste de la semaine le père Olive, l'instituteur de La Montagne, les
met sous surveillance.
Le 8 février, suite à une grande manifestation de soutien et face à l'importance que revêt ce conflit social, la
maréchaussée est appelée en renfort et charge les manifestants. Parmi eux se trouvent Jean et Emile. Il suffit d'un
rien pour qu'ils ne soient au nombre des personnes interpellées. Heureusement une âme bienfaisante et charitable, de
quelques mois l'aînée de Jean, est venue leur porter secours. Elle se prénomme Alphonsine.
Devant l'ampleur des affrontements et l'effet « boule de neige » du conflit, la Direction de Pontgibaud accepte de
s'asseoir à la table des négociations. Jean, bien que non concerné, s'identifie à cette victoire prolétarienne.
En 1906, de nombreuses grèves, certaines avec morts d'hommes, éclatent dans l'Ouest : Forges de Lorient-Hennebont,
Chaussures de Fougères, Nantes ... Au total, un demi million de prolétaires cessent le travail tout au long de cette
année.
Notre « Petit rouquin » - surnom dont il fut baptisé en raison de sa taille et de la couleur de ses cheveux - ne perd
pas une ligne des articles relatant ces différents conflits.
En juillet 1907, il passe avec succès son examen d'entrée à l'arsenal d'Indret et, le 23 octobre, Jean, Louis, Aimé,
Marie Cremet fait son entrée dans la grande famille des ouvriers d'Etat comme apprenti chaudronnier sous le matricule
n° 251O. Le responsable de ces apprentis est l'oncle d'Emile.
Ses camarades de promotion ont pour noms Francis Archambeau, Emile Bigeon, Ferdinand Boily, Jean Bugel, Emile
Brétéché, François Chaperon, René Charpentier, Emile Chupin, Georges Deniaud, Jean-Louis Dréan, Fernand Durand,
Pierre Fretin, Eugène Legal, Alfred Legrand, Henri Lodé, Joseph Padioleau, Joseph Royer et Marcel Vignet.
A sa grande satisfaction et malgré ses craintes, Jean-Marie voit les projets qu'il avait fondés pour son fils prendre
forme. Dans cette structure militaire, il espère bien que les instincts velléitaires de son rejeton vont s'estomper
et, pourquoi pas, disparaître.


 Consulter la page sur le site d'histoire de St Jean de Boiseau
Consulter la page sur le site d'histoire de St Jean de Boiseau